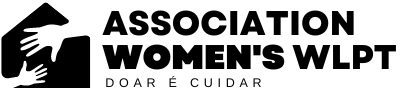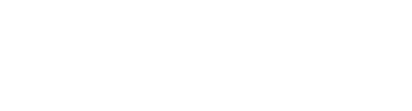L’attente, la déception et la naissance du contrôle
Il y a le monde, et puis il y a nous.
On ne vit pas seulement une histoire, on vit un rapport aux choses, un lien unique à l’autre. Et dans ce lien, chacun projette quelque chose de différent.
Face aux violences conjugales, les perceptions varient. Certains hommes, certaines femmes, entrent dans une relation avec des attentes très précises, parfois conscientes, parfois inconscientes. Il arrive que l’un cherche un couple, une stabilité sociale, un cadre. L’autre, lui ou elle, est dans l’amour, dans l’émotion, dans la croyance sincère en un lien profond. Ce décalage devient une faille.
Parfois, les mensonges précèdent même le mariage. D’autres fois, ils émergent après. Mais le choc est le même : une désillusion brutale, une promesse trahie.
L’un se révèle autoritaire, l’autre se retrouve prisonnier·ère d’un lien qui n’a plus rien à voir avec celui qui semblait exister. Ce qui était « amour » devient un espace d’attente non comblée, d’obligations, de renoncements.
Il est naturel d’avoir peur. D’anticiper. De vouloir s’assurer que l’on est aimé, protégé. Mais quand la confiance se construit sur des non-dits ou sur des mensonges, la structure se fissure.
J’ai entendu des récits bouleversants. Des femmes, des hommes, qui pensaient avoir trouvé un refuge et se sont retrouvés face à un miroir brisé. Ils avaient été mis en confiance, et l’autre avait menti. C’est là que le danger s’installe. Quand ce mensonge devient une stratégie, un moyen de contrôle.
Les violences conjugales ne naissent pas toujours d’un geste brutal. Elles s’installent dans le temps, dans une forme de décalage entre ce que l’on espérait et ce qui est. Dans les attentes projetées, jamais discutées, jamais reconnues. Puis dans la colère, dans la tentative de domination de l’autre.
La soumission devient une conséquence. Elle ne vient pas d’un choix, mais d’une lente perte de repères, de soi, de sa capacité à dire non.
Il faut oser reconnaître ces failles. Ce moment où l’amour bascule. Ce moment où l’un s’efface pour tenter de faire tenir le rêve à deux. Mais le rêve ne peut jamais tenir seul.
Manipulation et justice : un délit parfois invisible, mais bien réel
La manipulation psychologique est une forme de violence. Elle ne laisse pas toujours de traces visibles, mais elle marque profondément, affaibli, détruit. Quand une personne est amenée, par des pressions morales, des mensonges répétés, des menaces, à agir contre sa volonté, à renoncer à ses droits, ou à se soumettre à l’autre, il ne s’agit plus d’un simple conflit de couple : c’est un abus de pouvoir.
Dans plusieurs pays, dont la France et le Portugal, le droit reconnaît les violences psychologiques, et la manipulation mentale peut être punie par la loi, notamment dans les cas suivants :
- Harcèlement moral dans le couple, il s’agit de comportements répétés ayant pour but ou pour effet une dégradation des conditions de vie, une atteinte à la santé mentale ou physique.
- Emprise et privation de liberté (même sans violence physique), lorsqu’une personne est privée de ses choix, de ses mouvements ou de ses décisions par peur de représailles.
- Obligations imposées par la menace ou la peur (chantage, isolement, pressions morales, menaces sur les enfants, etc.).
Ces mécanismes sont difficiles à prouver, car ils se passent dans l’intimité. Mais ils laissent des traces dans les comportements, dans les émotions, dans les témoignages. La parole des victimes est donc essentielle.
Forcer quelqu’un à faire ce qu’il ne veut pas, par la peur, par la ruse, ou par l’amour déformé, c’est une violence.
C’est pour cela que les associations, les psychologues, les avocats et les tribunaux peuvent reconnaître la manipulation comme une arme de domination conjugale.